La parité dans le monde du rap, c’est encore une utopie. Pourtant, en Amérique Latine, les rappeuses féministes ne comptent pas s’effacer au profit d’une industrie musicale sexiste. Elles s’unissent, s’organisent et passent par des réseaux alternatifs pour être reconnues en tant qu’artistes et font bouger les lignes dans le secteur musical de toute la région.
Colombie. Au dernier étage d’un immeuble près du centre de Cali, Maria Rosé, Nicole et les quatre autres membres de leur crew répètent l’un de leur dernier son : “je suis une femme et j’ai des valeurs, alors je n’aime pas que tu me dises bonjour mon amour.” Casquette sur la tête, large t-shirt et tatouages sur le bras, Javier Cordoba les regarde fièrement. Aussi connu sous le nom de scène Reivaj_sow, il vient ici, deux fois par semaine, pour transmettre les valeurs du hip hop aux jeunes du quartier. Réflexion sur l’homophobie, acceptation des différences, discussions autour de l’actualité et surtout, cours d’écriture et d’apprentissage au rap… Les interventions de Javier Cordoba brassent large.

Ce processus, initialement imaginé et créé pour de jeunes garçons, n’est pas resté longtemps dans cette configuration. Les filles ont rapidement demandé à rejoindre le groupe.
“Elles ont aussi voulu avoir leur crew, leur propre groupe de rap. Puis elles ont trouvé leur nom : pouvoir féminin, pour montrer le pouvoir qu’elles ont et que toutes les femmes ont dans le hip hop et dans la vie. Elles le montrent en s’exprimant avec leurs paroles, leur engagement et leur discipline. “ Bien que garçons et filles apprennent désormais ensemble, c’est chacun son crew. Celui des filles s’appelle le “Crew Feminal Power” parce qu’il est important selon elles de mettre le mot “féminin” dans un groupe de rap.

Au quotidien, dans le cercle familial ou à l’école, les stéréotypes de genre leur collent à la peau. “Il y a des hommes qui disent que tu ne peux pas faire de rap parce que ce n’est pas féminin mais ils mentent parce qu’en étant des femmes, on peut obtenir toute la lumière”, clame fièrement Angie, de longs cheveux roux et de la colère dans la voix.
Derrière elle, Maria Rosé, 12 ans, poursuit : “ Les garçons d’ici nous soutiennent et on les soutient, mais au collège je montre ce que je fais et les gens rient mais je m’en fiche parce que quand on sera plus grandes, ils changeront de visage quand ils nous verront et ils arrêteront de se moquer.” Ici, les jeunes filles s’entraident et se poussent vers le haut, apprennent à être fières de ce qu’elles font et passer au-dessus des moqueries. Mais en arrivant, ce n’était pas la même histoire, se souvient Javier Cordoba, le président et initiateur de cette association : “la méthodologie d’apprentissage reste la même, il n’y a aucune différence de genre dans la manière d’enseigner. Pourtant, les filles ont plus peur d’y aller, elles ont besoin de se sentir en confiance, elles avaient du mal à se lancer”.
L’union fait la force
Un peu plus à l’Est, toujours dans la banlieue de Cali, Sandra Milena Londoño ouvre la porte de son studio. À l’intérieur, un piano, un micro, de la mousse sur les murs et un ordinateur. Depuis plus de 20 ans, cette rappeuse connue sous le nom d’artiste MC Saya se bat pour aider les femmes à être visibles dans la culture hip hop en Amérique Latine. Militante, féministe, MC Saya ne fait pas seulement de la musique. Ces dernières années, elle a créé un collectif, notamment pour donner des cours de rap aux femmes, des interventions en université et une mixtape réalisée avec des rappeuses du Mexique, de Bolivie, du Guatemala, de Colombie et d’Équateur afin de parler des discriminations qu’elles rencontrent dans chaque pays.
En Amérique Latine plus qu’ailleurs, les rappeuses féministes comptent sur l’union pour faire la force. Elles diffusent leur musique sur des plateformes non conventionnelles, donnent des concerts dans des lieux de luttes sociales, créent des collectifs souvent non-mixtes ou organisent des évènements festifs d’éducation populaire. “On est toujours occultées. On attend toujours des femmes qu’elles correspondent à certains types de musique, de paroles. Ces espaces entre femmes ont été créés parce qu’il n’y en a pas dans le hip hop. Entre femmes, on se reconnait et on s’entraide. En créant des collectifs, on s’aide à se visibiliser » regrette MC Saya.

Un constat partagé par Lise Segas, maîtresse de conférence en littérature et culture latino-américaine à l’université Bordeaux Montaigne. Depuis plusieurs années, elle étudie les mouvements féministes dans les cultures urbaines de plusieurs pays d’Amérique Latine.
« Les collectifs sont nés très rapidement de ce besoin de se retrouver, de sororité et d’entraide face à une société extrêmement machiste et violente et un secteur musical qui l’est, à l’image de la société dans laquelle il se développe. Ce besoin de se réunir est né d’une forme de survie, de protection aussi contre différents types de micro agressions ou d’agressions tout simplement. Mais je pense que la nécessité du collectif vient à la fois de cette culture extrêmement puissante de l’organisation militante féministe propre à l’Amérique Latine ainsi que d’un manque de moyen criant dans le secteur culturel musical.”
Sur le continent, l’émergence des collectifs féministes dans le monde du rap remonte aux années 2010. L’un des plus connus s’est formé au Mexique sous le nom de Batallones Femeninos avec pour objectif, la lutte contre les violences faites aux femmes à travers le rap. Dans ce collectif, 14 femmes essentiellement du Mexique et des Etats-Unis dénoncent les nombreux féminicides et parlent sans retenue de menstruations, de stéréotypes de genre où d’avortement. On pourrait aussi citer Somos Guerreras, un groupe également formé dans les années 2010 par trois rappeuses d’Amérique centrale : Nakury du Costa Rica, la Guatémaltèque Rebeca Lane et la Mexicaine Audry Funk. Dans cette partie du continent où l’industrie culturelle est très peu développée, l’union relève de la nécessité pour pouvoir émerger.
Contourner les réseaux traditionnels pour rester fidèle à ses convictions
Pour se faire connaître sur la scène du rap latino-américain, les rappeuses comptent donc sur la sororité. Virtuellement, elles s’organisent via les réseaux sociaux mais aussi via les plateformes de distribution gratuites sur lesquelles elles diffusent leurs musique. La démarche n’est pas forcément commerciale, il s’agit de partager au sein d’un public conquis.
En refusant de négocier avec l’industrie musicale et de se conformer aux normes de genres exigées dans le secteur, les plateformes alternatives deviennent donc une solution au manque de diffuseur·euses. La rappeuse équatorienne Caye Cayejera résume ce choix en quelques phrases : “je ne fais pas du rap pour devenir connue, je suis engagée dans ce travail car je sens qu’il y a des choses à dire. Vendre ma musique à la grande industrie musicale, ce serait compromettant pour ma lutte. L’art, avec sa capacité à transformer, est un outil que je veux utiliser en faveur des espaces où je suis acceptée et où je peux faire entendre ma voix, mais je ne veux pas transformer mon ego pour être au centre de l’industrie musicale. Ce serait comme vendre mon corps, j’ai des convictions très claires : je ne vais pas censurer mes paroles ni changer mon style vestimentaire pour faire partie de cet ensemble. Ces espaces de production ont un filtre très masculin”.
Physiquement, les rappeuses féministes partagent donc leurs musique dans des espaces autogérés militants : syndicats, locaux associatifs de défenses pour personnes LGBTQI+, festivals féministes… À Mexico par exemple, la Gozadera, un local se définissant comme « lesbo féministe vegan », ouvre régulièrement sa porte à des rappeuses militantes féministes pour proposer différents types d’initiatives : ateliers d’écritures, de réflexion, scène ouverte en non-mixité.

Ces différents lieux leur permettent de se faire connaître au sein de réseaux militants, souvent puissants et connectés entre différents pays. “Je veux vendre mon travail avec de l’argent social dans des lieux de rencontres comme les marches, les mobilisations, les centres communautaires, les syndicats… Ce sont des plateformes de productions populaires, c’est là que je veux être. S’il n’y avait pas cette sororité entre femmes, amies, collègues, je n’aurais pas montré mon travail dans tant de pays. Il y a une capacité de production féministe pour la partie organisation qui fait circuler l’art des femmes. Grâce à ça, j’ai pu voyager sur tout le continent” poursuit Caye Cayejera.
Résultat : face au manque de moyens et de changements dans l’industrie musicale classique, les rappeuses sont plus souvent connues hors de leur pays que chez elles.
Des mouvements minoritaires mais en plein développement
Bien que la musique des rappeuses militantes féministes se développe essentiellement sur des réseaux alternatifs, la présence des femmes dans le secteur traditionnel augmente petit à petit. Depuis le début de la lutte, quelques messages d’espoirs surgissent pour les rappeuses, à l’image de la nomination récente de l’une d’elles à la présidence du plus grand festival de hip-hop d’Amérique Latine, Hip-hop al Parque en Colombie. Depuis, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à y être programmées. “De plus en plus d’initiatives et de stratégies sont mises en place. On est au tout début d’un mouvement qui va s’amplifier et gagner en force” prédit Lise Segas.
Partout sur le continent, plusieurs festivals mettent à l’affiche uniquement des femmes. C’est le cas du Ruidosa fest au Mexique, au Chili et au Pérou, le cas également du Matria Fest au Chili où encore plus récemment, le Festival de mujeres músicas del Perú.
En 2018, le collectif féministe latino-américain Somos Ruidosa a mené une étude sur la représentations des femmes dans les festivals latino-américain. Résultats : seuls 10 % de groupes composés de femmes. Un an plus tard, en 2019, l’Argentine votait une loi pour garantir au moins 30 % de femmes dans la programmation des festivals. Partout ailleurs, la route est encore longue pour les rappeuses féministes d’Amérique Latine.
Texte et photos : Maud Calves





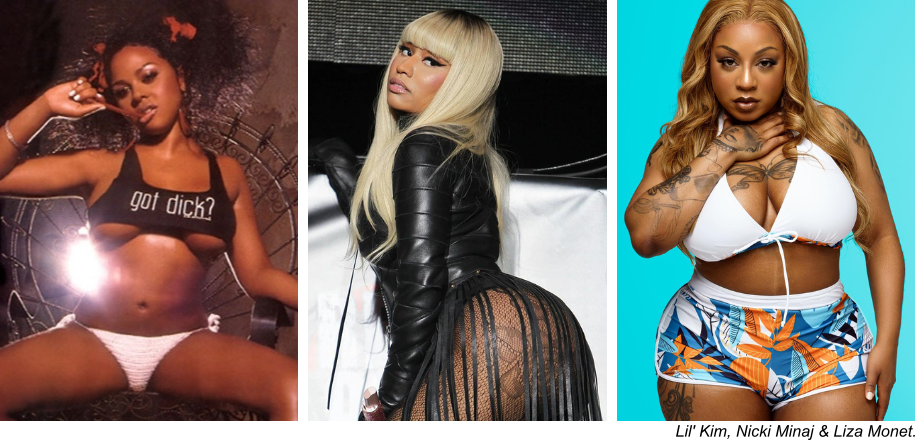


JE SOUTIENTSVOTRE FORCE!
LIBERONT NOUS DES HOMMES