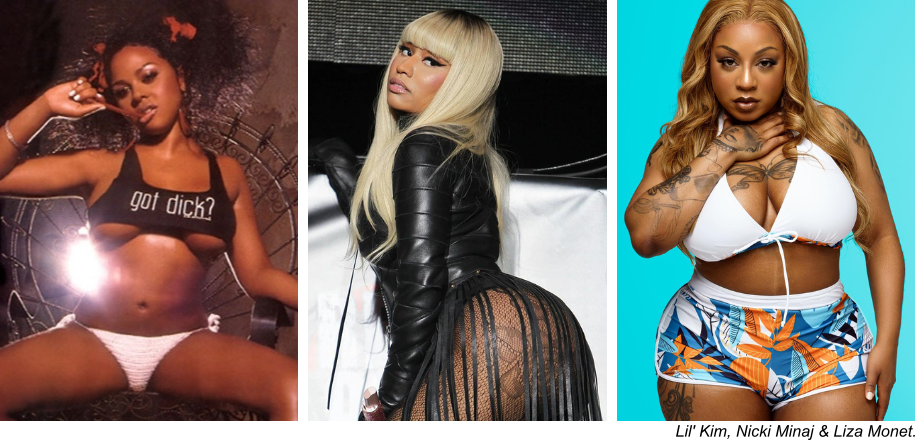Rappeuse, chanteuse, compositrice, actrice et militante antiraciste et pro LGBT+, Linn da Quebrada se définit comme « femme queer, trans et noire ». Élevée au sein des Témoins de Jéhovah, elle grandit dans les favelas de São Paulo. En 2017, son album Pajubá, pensé comme l’équivalent trans de Lemonade de Beyoncé, lui confère le statut d’icône queer sur la scène musicale brésilienne. L’artiste nous parle de son parcours dans le hip hop, de son activisme et de son art pluriel et inclusif qui transcende les étiquettes.
Quand et comment as-tu découvert le hip hop ?
Mon premier contact avec le hip hop est arrivé assez tard, vers la fin de l’adolescence. Je ne songeais pas encore à écrire ou chanter, mais quand j’ai commencé à faire du théâtre, je me suis rapprochée de mon corps et je me suis mise à mieux préciser les questions qui m’agitaient. À ce moment-là, la musique est à la fois devenue une possibilité et un outil impossible. Je n’avais aucune idée de comment/ou de si j’étais capable d’en faire. C’est l’époque où je vivais avec la célèbre chanteuse trans brésilienne Liniker et je me souviens que le fait d’observer sa puissance et ses nuances m’a aussi inspirée.
Je me suis alors dit que la musique pouvait être un bon moyen de dialogue et de communication pour moi aussi. Le style et la forme ne sont pas venus avant le contenu mais tout est venu en même temps. Et j’ai vu, surtout dans le baile funk, un chemin que j’avais envie d’emprunter. Ça faisait parfaitement sens pour moi. Je me suis rendu compte qu’en plus de parler de mes désirs et de mes affections, je pouvais aussi créer et produire de nouveaux désirs et de nouvelles affections. J’ai écrit ce que j’avais envie d’entendre, pour le plaisir de dire chaque mot et aussi d’organiser ma pensée.
Toutefois, je n’avais pas nécessairement l’intention de faire du rap ou du funk. Je chantais pour être entendue, pour comprendre et me perdre en même temps. Les chansons ont presque jailli. Avec la musique, je marche sur un chemin où ce que je ressens et ce que je veux ressentir font sens et nous permettent de nous rencontrer.
Comment as-tu commencé à rapper ?
J’ai grandi en essayant d’imiter les pas de danse du groupe É O Tchan! et des émissions de télé brésiliennes comme Chiquititas, Fada Bela, Domingo Legal, et Praça é Nossa. J’ai grandi en regardant à la télé la célèbre drag queen et popstar Vera Verão, qui me donnait le sourire, pendant que les autres riaient au salon. J’ai grandi en dansant sur Lacraia, une performeuse trans qui dansait aussi dans plusieurs émissions de télé. Je crois que j’ai fini par incorporer un peu de tout ça.
« Ma famille a beaucoup pesé dans ma construction. »
Qui étaient tes modèles quand tu étais petite ?
Quand je pense aux modèles et aux personnalités qui m’ont inspirée quand j’étais petite, je me rends compte que ma famille a beaucoup pesé dans ma construction. Et pèse toujours aujourd’hui. Avec tous les aspects positifs et négatifs que cela implique, et tout ce qui existe entre les deux.
J’ai grandi dans une famille composée de nombreuses femmes. Des femmes fortes, en colère, qui ont élevé leurs filles toutes seules, ont dû gérer l’absence de leur mari, qui avaient passé leur vie à chercher à se marier mais étaient aussi avec d’autres femmes. Des femmes qui se sont senties frustrées à cause de ça. Qui ont géré cette frustration, se sont endurcies et ont construit une carapace pour se protéger. Des femmes qui sont devenues des murs protecteurs et m’ont appris que moi aussi, j’allais devoir apprendre à me protéger.
J’ai grandi avec Dieu pour modèle. J’ai grandi en apprenant que nous étions créés à son image et selon sa ressemblance. Mais plus j’ai grandi, plus je me suis sentie différente de l’image que je devenais, et donc plus je me suis éloignée de ce modèle.
Tu as été élevée au sein de la religion des Témoins de Jéhovah. En quoi cela a-t-il influé sur la construction et le développement de ton identité ?
La religion a joué un rôle fondamental dans ma construction. En tant que Témoin de Jéhovah, j’ai reçu une éducation très stricte et aimante. J’ai beaucoup étudié la Bible, une version qui considérait mes futurs choix comme des péchés. Cela m’a amené à développer une relation de culpabilité avec moi-même. Et précisément pour cette raison, cela m’a conduit à rompre cette relation et à prendre la responsabilité de mes décisions.
Je pense que mon rapport à la religion, combiné à mon rapport à la parole, aux mots, et à l’écriture, a eu des vertus positives. Cela m’a appris à me connecter à moi-même et à comprendre que je ne pouvais croire qu’à un Dieu qui croyait aussi en moi. C’est pourquoi je pense que ma musique et mon art traduisent cette relation entre le sacré et le profane. Où je trouve des corps qui construisent et renforcent ces égrégores en moi.
Tu viens de São Paulo. Quelle relation entretiens-tu avec cette ville ?
À l’adolescence, j’habitais à la campagne et rêvais de vivre à São Paulo. Dans ma tête, et dans la tête de beaucoup de gens il me semble, c’était la ville de toutes les opportunités. Mais ces opportunités ne sont pas du tout équitablement réparties. J’aimais la vigueur, le mouvement, la nouveauté, la rencontre, la différence. Et c’était très précieux pour moi de pouvoir rencontrer des personnes qui renforcent et valorisent mes idées. Ces relations m’ont permis de devenir quelqu’un d’autre et de m’autoriser à laisser émerger de nouvelles idées.
« Je vois São Paulo comme une étape et non comme une ligne d’arrivée. »
Cependant, aujourd’hui, je vois combien São Paulo nous prend aussi beaucoup. Je vois combien cette relation est injuste et comment j’ai dû migrer ici pour bénéficier de prétendues opportunités économiques et financières. Je suis très reconnaissante de tout ce que j’ai construit ici et de tout ce que j’ai connu, tout le mouvement qu’on génère et tout ce que nous avons bâti. Mais je vois combien il est important d’élargir nos horizons et de voir au-delà des frontières que le « paradis du sud-est » nous promet. Aller au-delà de ce besoin pour se déplacer au centre. Malgré toute la richesse et la prospérité culturelle qui existent dans les périphéries, les bords et les marges doivent se déplacer au centre pour transformer tout ça en monnaie d’échange.
Pour cette raison, São Paulo continue pour moi d’être cette ville pleine de contradictions, de rencontres et d’incompatibilités qui m’ont permis de créer, mais je la vois actuellement comme une étape et non comme une ligne d’arrivée.
Quel titre conseillerais-tu d’écouter en premier à quelqu’un qui veut découvrir ta musique ?
Cela dépend beaucoup du moment où la personne me découvre. Mais aujourd’hui, je lui dirais d’écouter Quem soul eu (qui que je sois). Parce que je me vois et me reconnais dans le doute et l’incertitude, dans la peur et le courage, dans la mélodie, dans les arrangements composés par BadSista. C’est l’un de mes morceaux préférés. Je le trouve mature et bien construit. Aussi parce qu’il porte cette question qui me définit : qui suis-je après tout ? Après avoir été, Bixa Preta, Mulher et Bixa Travesty, « quem soul eu ? »
Un grand nombre de tes chansons célèbrent les femmes cis, trans et noires. Ta musique est-elle une forme de militantisme ?
Je vois ma musique comme une partie des outils et des plateformes que j’utilise pour faire de l’art, communiquer et construire des ponts. Je comprends que les gens voient aussi ce que je fais comme de l’activisme ou de l’artivisme, et que cela vient du fait que mes actions sont perçues de manière politique. Et c’est pour cette raison que je ne mets pas de moi-même dans cette catégorie.
« Les femmes noires, trans et féministes sont multiples et plurielles. »
Parce que, selon moi, toutes les formes de manifestations artistiques et esthétiques sont politiques. Je n’ai pas envie de m’étendre sur la question, mais je vois que très souvent, ces appellations proviennent d’un marché qui cherche à nous catégoriser, à nous séparer, et donc à anticiper nos mouvements. Peut-être que c’est ce marché qui nous enferme. Ou la manière dont ce marché s’approprie nos marques et nos cicatrices pour en faire ses propres slogans, au sein de ses propres marques et institutions. Nous incorpore dans ses corporations.
Les femmes noires, trans et féministes sont multiples et plurielles, avec des besoins, des endroits, des exigences et des lignes directrices différentes. Néanmoins, elles se retrouvent toutes au carrefour mercantile du corps. Le corps nous unit, nous connecte et nous différencie.
Tu es aussi actrice, présentatrice télé et militante LGBT+. Combien parviens-tu à concilier tout ça ?
Je concilie tout ça avec le plus grand plaisir ! J’adore chacune de ces activités parce que j’ai le sentiment que c’est leur jonction et leur rencontre qui font que je me trouve en tant qu’artiste. Je ne me vois pas comme une chanteuse, mais je chante. Je chante pour être entendue et je chante aussi pour trouver le silence.
« Je sors du besoin de parler de moi afin de pouvoir entendre. »
En tant qu’actrice, mon corps devient un canal et j’ai alors la possibilité de vivre différents récits, fréquences et histoires. Je peux incorporer et romancer mon corps dans des relations nouvelles ou différentes. Étant très curieuse, le fait d’interviewer d’autres personnes est un réel plaisir. Je me mets en position de regarder l’autre, de l’extérieur, je sors du miroir et du besoin de parler de moi, afin de pouvoir entendre. Ouvrir la fenêtre. Et sauter.
Comment écris-tu tes textes ? As-tu des routines particulières ou des sujets de prédilection ?
Ça change beaucoup. Même plus que je ne le voudrais. Avec Pajubá, tout est sorti d’une traite. Quand je m’en suis rendu compte, j’avais déjà un album entier. Je savais ce que je voulais dire. Je savais ce qui devait être dit. J’avais une cible très claire et la cible n’était pas blanche : j’ai d’abord chanté pour moi-même, parce que j’avais besoin d’entendre. Et la plupart du temps, c’est comme ça que je fonctionne. Je le fais parce que j’en éprouve le besoin.
Mais les choses peuvent être encore plus complexes, parce que parfois on ne sait pas, ou on n’a pas la présence d’esprit ou le recul nécessaire, de comprendre ce dont on a réellement besoin. C’est la question qui m’anime en ce moment, où est-ce que je vais ? Quelles coupures sont nécessaires ? Quelles blessures faut-il soigner ? Vers où orienter mon regard, dans quel arbre me nicher et élire domicile ? Peut-être que je suis un petit oiseau qui apprend encore à chanter. Et quand il ne vole pas, il se pose. Parce qu’une pause est aussi une forme mouvement. Alors je compose et décompose.
En France, les gens pensent souvent que le rap est le genre musical le plus LGBTphobe. Que réponds-tu à ça ?
J’ai l’impression que ce n’est pas seulement le cas en France, mais partout dans le hip hop ou dans la musique. Nous vivons dans une société LGBTphobe. Et pour être honnête, j’en ai assez de le répéter tout le temps. Parce que si on regarde autour de nous, on se rend compte que nous sommes présents dans très peu d’espaces. Dans presque aucun, surtout sur le marché du travail. On le sait et on fait semblant de ne pas le voir. On fait semblant d’y arriver, d’avoir ce privilège. Mais moi et les miens n’avons pas cette possibilité. Ce que l’on remarque, c’est notre absence. Ou parfois la dissimulation ou l’unique représentativité qui vise à nous distraire avec une personne censée représenter toute une communauté, dans sa totalité, multiple et plurielle.
« Nous sommes là, à envahir, occuper, agiter, améliorer, diversifier et transformer ces espaces. »
C’est pour ça que je ne dis pas que le hip hop est LGBTphobe. Sinon, je devrais dire que le journalisme, le cinéma, l’Église, la télévision, le théâtre, l’art contemporain, l’ingénierie, la médecine – et toute une liste interminable – sont très LGBTPhobes. Mais malgré ça, nous sommes là, à envahir, occuper, agiter, améliorer, diversifier et transformer ces espaces. Dont la musique et aussi le hip hop.
Ici au Brésil, il y a plusieurs exemples de groupes et de chanteurs qui ont construit des œuvres magnifiques, fortes et puissantes en ce sens. Ils n’ont peut-être pas autant de visibilité précisément en raison de ce réseau LGBTphobe que j’ai fait semblant de ne pas voir, jusqu’à ce que cela devienne insoutenable. Un réseau qui, petit à petit, s’effondre sous nos yeux.
Quel impact la politique de Bolsonaro a-t-elle sur les personnes noires et trans au Brésil ?
Ce que je remarque c’est que cette politique a fait du tort à la population tout entière avec une mauvaise gestion de tout. Et pas seulement envers la communauté TLGB, qui a été frappée de plein fouet par l’absence de politiques publiques et de prise en compte de nos problématiques et de nos corps, mais nous sommes tous témoins de leur manque de préparation.
D’autant plus en cette période de pandémie, où la population qui est déjà en marge, sans emploi, et souvent sans logement, n’a aucun moyen de trouver les ressources nécessaires pour rester en vie et un minimum en sécurité. C’est dans ce genre de moments qu’on voit que nos corps ne comptent pas et ne sont pas une priorité.
En même temps, le fait de se construire politiquement dans notre pays a des côtés positifs. Nous avons Erica Malunguinho, députée noire et trans qui fait un travail incroyable dans ce contexte d’urgence. Et aussi Erika Hilton, conseillère municipale noire et trans de la métropole de São Paulo élue en 2020. En d’autres termes, nous vivons sur un territoire instable et plein de contradictions. Mais sur un territoire en mouvement, sous tension et en pleine transformation.
Retrouvez Linn da Quebrada sur son site, Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.